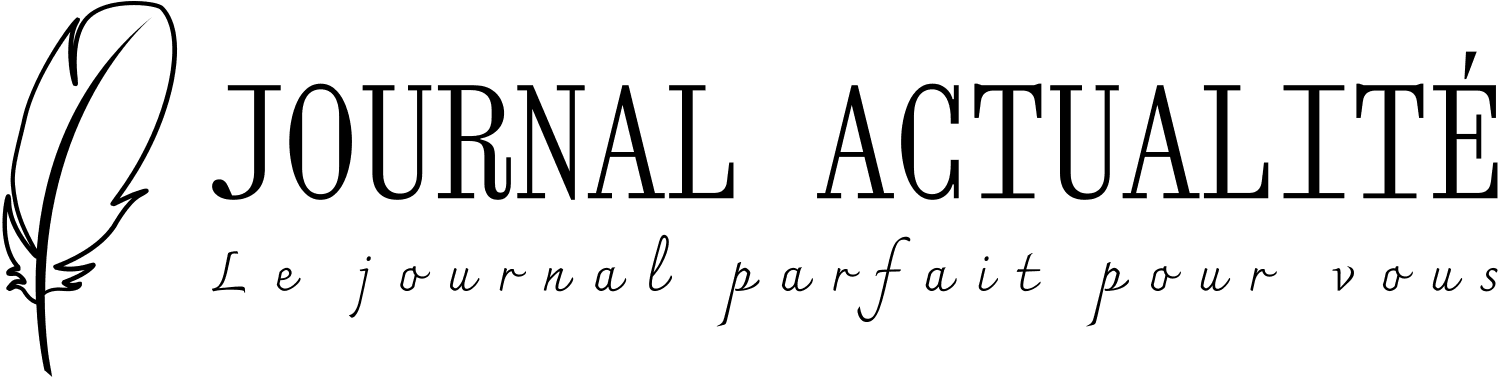Elle arrivait sur scène les poings tendus. En noir. Des pieds à la tête. Avec une frange qui lui mangeait les yeux. Le regard d’une combattante. Le sourire d’une amante. La voix d’une militante. Les mots d’une magnifique perdante. Comme aurait pu l’écrire Leonard Cohen si elle avait été une égérie warholienne du Chelsea Hotel. Sauf qu’elle était debout. Plus pasionaria tumultueuse qu’éphémère superstar. Panthère prête à bondir sur tout ce qui peut faire mal ou salir la beauté. Rock. Révoltée. Radicale.
En l’écoutant, en la voyant, on se disait que cette femme-là ne devait rien à personne, quitte à en payer le prix. Elle était la Ribeiro, sœur des sans-grade, de ceux qui ont appris leur enfance face aux fumées d’usine, de ces écorchés vifs qui ont connu la douleur avant le plaisir. Mais aussi, la Grande Catherine, sorte de Janis Joplin saisie par Baudelaire, de Nico emportée par Rimbaud, de Piaf électrocutée par Apollinaire. Catherine Ribeiro est morte dans la nuit du jeudi 22 août au vendredi 23 août, selon une annonce de son entourage à l’Agence France-Presse. Elle était âgée de 82 ans.
« Les paroles ne sont qu’un accessoire, je préférerais qu’on en arrive presque à des onomatopées pour remplacer les paroles. On le fera peut-être. Il faudrait que la voix serve d’instrument… Ce que je cherche à faire, c’est détruire complètement la chanson classique, avec refrain et couplets réguliers », disait-elle dans un entretien en 1970. C’était un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Sur des musiques au bord de la transe qui provoquaient d’étranges bacchanales dans les villes et les campagnes, Ribeiro et ses camarades d’Alpes en appelaient à la liberté, à l’insurrection, à l’amour, à la poésie, à la colère…
Pendant dix ans, de 1970 à 1980, la télévision les ignora, la radio les bouda, la grande presse les regarda de haut. Ce qui ne les empêcha pas de donner des milliers de concerts, de remplir des salles aussi prestigieuses que l’Olympia ou Bobino, de vendre des dizaines de milliers d’exemplaires de leurs albums. La marginalité, ils ne la revendiquaient pas, elle leur fut imposée.
Rage inextinguible
Au départ, il y a une petite fille sauvage, qui grandit dans une famille modeste d’origine portugaise, à Saint-Fons, dans la banlieue lyonnaise. Père taiseux, ouvrier et proche des communistes à Rhône-Poulenc. Mère illettrée, qui la frappe et ne la comprend pas, mais lui transmet sa belle voix de chanteuse de fado. « J’ai appris ma naissance/A travers les lignes/D’un discours anguleux/Sur l’échec de l’amour/J’ai appris mon enfance/Face aux fumées d’usine/Par les chemins de grèves/Empruntés par mon père », chantera-t-elle dans La Vie en bref.
Il vous reste 63.97% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.